par Érik Bullot
Au fil des métamorphoses du cinéma à l’ère numérique, la séance de projection en salle, après avoir coïncidé depuis son institutionnalisation avec la définition même du septième art dans l’esprit du public, connaît de multiples renversements qui attestent une perte de stabilité ontologique du médium. Le rituel de la séance représente-t-il une simple parenthèse dans l’histoire du cinéma ? Non seulement le film s’« expose » désormais dans les musées, les galeries ou les centres d’art, s’affiche sur l’écran des ordinateurs et des téléphones mobiles, se dissémine dans l’espace social, mais la présentation des films emprunte souvent de nouveaux avatars, pédagogiques ou bonimentés, proches de la performance didactique, de la conférence, de l’impromptu poétique ou de la séance de ciné-club. Il est frappant d’observer la récurrence dans le champ de l’art contemporain de la « conférence performative » en relation avec le cinéma. Sous des formes multiples, hybrides, ambivalentes, ces conférences semblent renouer avec le cinéma des premiers temps tout en accusant une dimension souvent conceptuelle (la conférence se substitue au film lui-même). Pensons aux séances Alchimicinéma au cours desquelles sont présentés par Jean-Marc Chapoulie, à la fois projectionniste et bonimenteur, des films trouvés, amateurs, familiaux, industriels, scientifiques ou pédagogiques, selon des formats et des durées très divers, au film de Christelle Lheureux L’Expérience préhistorique (2003-2008), remake des Sœurs de Gion (Mizoguchi, 1936), dont chaque projection donne lieu à des exercices de boniment en hommage à la figure du benshi [1]. Citons les conférences, intitulées Plans de situation, données par l’artiste Till Roeskens qui relate avec tact et humour ses déambulations dans le paysage urbain, traçant la cartographie complexe de ses déplacements, restituant les dialogues échangés avec ses interlocuteurs, détaillant l’architecture vernaculaire des lieux (l’expérience devient parfois un film, comme pour Plan de situation : Joliette, 2010), les lectures de Marcelline Delbecq, placée devant un écran sur lequel sont projetés des textes qui font office de sous-titres (Glimpses) ou les performances didactiques de Louise Hervé et Chloé Maillet proposant une « bande-annonce en acte » d’un film à venir (La bande-annonce de notre film est une performance, 2006) [2].

Projeté par fragments sur un écran, évoqué par des récits ou des légendes, virtuel dans le contexte d’un simple énoncé performatif, le film est mis en équation. Il ne s’agit plus seulement de le projeter, mais de l’inventer sous les yeux du spectateur, de l’animer, voire de le réanimer. En instituant un mode d’adresse par le biais de causeries et d’improvisations verbales, la relation au spectateur est renouvelée. Ces différentes conférences performatives expriment un vœu didactique au diapason, semble-t-il, du « tournant éducatif » de l’art contemporain qui voit des artistes inventer des dispositifs pédagogiques singuliers, démocratiques ou libertaires [3]. La conférence performative s’inscrit dans ce courant de recherche artistique lié à la production du savoir en déconstruisant la forme de la leçon, en moquant la figure du maître, en distribuant la parole [4]. On peut aussi interpréter ces performances comme des formes dérivées du dispositif du cinéma lui-même, œuvrant à son élargissement par un dialogue critique avec son histoire. Elles relèvent en effet de la tradition des spectacles de lanterne magique, destinés au divertissement et à la pédagogie, mais aussi du cinéma des premiers temps marqué par la présence du bonimenteur [5]. La conférence et le bonimenteur n’ont d’ailleurs jamais totalement disparu. Différentes formes ont subsisté dans des contextes pédagogiques : classes de physique ou de sciences naturelles dans les milieux scolaires, faisant usage d’un projecteur 16 mm, d’un épiscope ou d’un rétroprojecteur ; conférences publiques consacrées à la géographie ou à l’ufologie. Mentionnons les conférences organisées par l’association Connaissance du monde, fondée en 1945 par Camille Kiesgen, qui ont connu un réel succès populaire dans certains pays francophones. Contemporain d’un moment de diffusion du savoir où des personnalités scientifiques se livrent à des expériences filmiques et médiatiques (Alain Bombard, Haroun Tazieff, Jacques-Yves Cousteau, Michel Siffre), le succès des conférences est grand [6]. Cette tradition représente une ligne généalogique possible à laquelle les performances dans le champ de l’art contemporain font parfois allusion, de manière ironique, pour sa part d’approximation scientifique, de confusion entre le théorique et l’anecdotique, comme le soulignent les reproches adressés par l’auteur de Tristes tropiques aux « conteurs d’aventures » qui se produisent salle Pleyel.« Le détail des caisses emportées, les méfaits du petit chien du bord, et, mêlées aux anecdotes, des bribes d’information délavées, traînant depuis un demi-siècle dans tous les manuels, et qu’une dose d’impudence peu commune, mais en juste rapport avec la naïveté et l’ignorance des consommateurs, ne craint pas de présenter comme un témoignage, que dis-je, une découverte originale » [7].
Dans un film ironique et grave, Connaissance du monde (Drame psychologique) réalisé en 2004, le cinéaste Philippe Fernandez rend hommage au dispositif de la conférence. Interprété par Bernard Blancan, le causeur spécialiste d’ufologie, cinéaste amateur épris de théories sur les rencontres rapprochées [8], présente son film de voyage tourné sur l’île de Pâques. Connaissance du monde confond progressivement le discours érudit et quelque peu délirant du conférencier et le film d’aventure géographique au cours d’un processus troublant qui témoigne d’une curieuse porosité entre le film et la conférence.
Mais quel est le lien, de manière plus générale, entre le cinéma des premiers temps, la figure du bonimenteur, la conférence illustrée, et la « conférence performative » contemporaine ? Ce lien semble obscur, indirect. L’histoire du cinéma travaille à rebrousse-poil par retours et survivances, comme en témoignent les lacunes historiographiques entre le cinéma élargi des années 1960-70, oublié, voire refoulé, au cours des années 1980-90, et le cinéma d’exposition contemporain qui multiplie à loisir les écrans, exhibe les projecteurs, invite le spectateur à déambuler, actualisant une mémoire dont il est souvent le dépositaire à son insu [9]. Comment penser ce laps, ce retard ou ce délai ? Est-il structurel, dû à la nature fragile et éphémère de la performance, ambivalente dans sa relation à l’archive, ou traduit-il un jeu plus complexe entre le cinéma et ses élargissements ? Qu’en est-il à cet égard de la conférence ? En supposant la présence de l’artiste ou du cinéaste, projectionniste ou bonimenteur, doué de parole, et la possibilité d’une projection, réelle ou virtuelle, la conférence ressortit-elle à la catégorie du cinéma élargi, à la manière d’un nouveau paradigme ? L’actualité récente de cette forme nous invite à poser quelques jalons d’une généalogie, discontinue et lacunaire, de la conférence comme film.

« C’est la première fois qu’on introduit le ciné-club dans le cinéma, c’est-à-dire qu’on préfère la réflexion ou les débats du cinéma sur le cinéma au cinéma ordinaire en tant que tel », déclare Daniel, le héros du Traité de bave et d’éternité (Isidore Isou, 1951) sur la bande sonore du film, en sortant, de manière sans doute allégorique, d’une séance de ciné-club où est projeté un film de Chaplin, L’Opinion générale, altération du titre original L’Opinion publique. On ne peut qu’être frappé par les propositions lettristes sur le renversement de la séance de cinéma. Isidore Isou annonce la primauté du débat sur le film. « Le cinéma étant mort, on doit faire, du débat, un chef-d’œuvre. La discussion, appendice du spectacle, doit devenir le vrai drame. On renversera ainsi l’ordre des préséances » [10]. Contemporaine d’une crise de l’avant-garde à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la leçon lettriste répond à une clôture historique du médium en revendiquant un âge ciselant du cinéma, caractérisé par la « destruction des ensembles et l’émiettement des particules » et un principe d’autoréflexivité. « Je crois premièrement que le cinéma est trop riche. Il est obèse. Il a atteint ses limites, son maximum. Au premier mouvement d’élargissement qu’il esquissera, le cinéma éclatera ! », énonce Daniel, péremptoire. Il s’agit dès lors d’introduire la réflexion dans le film lui-même, de procéder à un montage discrépant qui exaspère la disjonction entre le son et l’image, de ciseler le matériau photographique par des interventions directes sur la pellicule. Parallèlement à ces différentes stratégies pratiquées par Isou dans son film, la bande sonore donne à entendre un long discours qui bonimente le projet sous la forme d’un manifeste. Le film est-il devenu une conférence fleuve [11] ? En novembre 1951 au Musée de l’Homme à Paris, lors de la présentation de son film Le film est déjà commencé ?, Maurice Lemaître propose une séance de syncinéma qui vise un élargissement du cinéma en incorporant l’intervention d’acteurs, la participation des spectateurs et des actions sur l’écran. Dans la version du film publiée en 1952, accompagnée d’une préface d’Isou et de « Notes sur le syncinéma », Lemaître insiste sur la nature à la fois discursive et performative du film en décrivant précisément la bande sonore et les interventions dans la salle. Il souhaite opérer une « transformation de la représentation cinématographique en un combiné théâtral avec participation du film, par l’introduction des éléments salle et écran dans le spectacle cinéma » [12]. Autant de propositions qui opèrent une déconstruction du rituel de la séance par un acte performatif, selon la terminologie austinienne des actes de langage, à l’instar de la théorie du cinéma infinitésimal développée par Isou qui confie à l’artiste le soin de proposer des éléments ou des énoncés pour un film imaginaire. On en trouve de nombreux exemples chez le lettriste Roland Sabatier.
« […] l’artiste présente des notes, des ébauches diverses, des scénarii n’ayant encore, selon ses dires, jamais été rendus publics. En les proposant, l’artiste exprime le regret de n’avoir pas eu suffisamment de moyens matériels pour réaliser, notamment, des œuvres sur pellicule. Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, il invite son assistance, après qu’elle ait pris connaissance de ces traces, à effectuer un voyage mental, à la suite duquel il peut y avoir une discussion évolutive et inédite sur le thème de l’homologation » [13].
Ces différents exemples qui procèdent à un renversement de la séance anticipent certains postures de l’art conceptuel, à l’instar des instructions de Sol LeWitt ou des discussions de Ian Wilson. Pensons à la « dématérialisation » de l’œuvre et à l’importance accordée à la dimension verbale de la performance. On peut s’interroger là encore sur l’amnésie qui a recouvert les activités lettristes, en dépit de quelques travaux méritoires, témoignant d’une réelle résistance à inscrire dans l’histoire du cinéma ces tentatives d’élargissement.
La situation américaine est sensiblement différente en regard de la reconnaissance institutionnelle du cinéma expérimental au sein de l’enseignement artistique et du statut des avant-gardes. Sans doute John Cage aura-t-il été l’un des artistes majeurs à avoir inventé une forme originale et singulière pour ses conférences « en utilisant », écrit-il « des moyens de composition analogues à mes moyens de composition utilisés dans la musique » [14]. Dans son volume Silence, publié en 1961, plusieurs transcriptions de ses conférences sont accompagnées de didascalies et d’indications de durée et de rythme qui font de ces causeries de réelles performances musicales par leur jeu réglé de la parole.
« Mon intention a souvent été de dire ce que j’avais à dire d’une manière qui servirait d’exemple ; qui pourrait, éventuellement, permettre à l’auditeur d’éprouver ce que j’avais à dire plutôt que d’en entendre simplement parler. Ceci veut dire que, me consacrant comme je le fais à des activités diverses, je me suis efforcé d’introduire dans chacune d’elles des aspects limités par les conventions à l’une ou à plusieurs des autres » [15].
La conférence n’est plus l’exercice d’illustration ou de promotion de l’œuvre artistique, à la manière de nombreuses conférences d’artistes qui passent en revue chronologiquement leurs productions, mais le lieu d’une invention formelle permettant à des « éléments musicaux (temps, son) de s’introduire dans le monde des mots ». Les solutions imaginées par Cage sont nombreuses, comme le révèle la typographie du volume qui multiplie les polices et les solutions graphiques. Pour « 45’ for a Speaker » (Composer’s Concourse, Londres, 1954), le conférencier dispose de deux secondes par ligne tandis que pour « Indeterminacy » (Exposition universelle de Bruxelles, 1958), constitué d’un répertoire de courtes histoires, il dispose d’une minute par récit, ce qui l’oblige à accélérer ou ralentir le débit selon la longueur de chaque histoire et induit une marge d’indétermination. Le texte de la conférence est semblable à une partition que le conférencier doit interpréter ou performer. En régulant le rythme de la parole, la conférence obéit à des principes de composition musicale qui l’assimile à une forme artistique propre.
Le 30 octobre 1968, au Hunter College de New York où il enseigne la photographie et le cinéma, le cinéaste américain Hollis Frampton présente une conférence, intitulée de manière tautologique, « A Lecture » [16]. Après avoir mis en marche un magnétophone placé devant le public, il se dirige vers le fond de la pièce près du projecteur 16 mm qu’il actionnera selon les indications de la voix préenregistrée, confiée à un alter ego, le cinéaste canadien Michael Snow. Le conférencier est-il devenu projectionniste ? Rappelons qu’un an auparavant Frampton s’écroule dans le loft de Wavelength (Snow, 1967). La conférence obéit à un lent mouvement spéculatif. Le discours envisage dans un premier temps les circonstances générales de la séance cinématographique pour questionner ensuite, de manière ironique et spéculaire, les modalités de la situation présente. Après avoir évoqué l’obscurité de la salle, le conférencier souligne les propriétés du rectangle de lumière de l’écran.
« Ce n’est qu’un rectangle de lumière blanche. Mais c’est en même temps tous les films. Nous ne pourrons jamais en voir plus à l’intérieur de notre rectangle, seulement moins » [17].
Un film est rendu visible, nous dit-il, par un effet physique de soustraction lumineuse. Après que le projectionniste ait placé un filtre rouge devant l’objectif, la voix déclare :
« Si l’on voyait un film rouge, s’il s’agissait là d’un film de couleur rouge, n’en verrions-nous pas davantage ? Non. Un film rouge soustrairait le vert et le bleu de la lumière blanche de notre rectangle. Ainsi, si nous n’aimons pas ce film-là en particulier, nous ne devons pas dire : Il n’y en a pas assez ici, je veux en voir plus. Nous devons dire : Il y en a trop ici, je veux en voir moins » [18].
L’énoncé est paradoxal. Alors qu’aucun film physique n’est projeté sur l’écran, le faisceau lumineux est censé contenir tous les films possibles. L’expérience a priori déceptive du spectateur se révèle riche d’enseignement philosophique, rappelant l’allégorie platonicienne de la caverne. En plaçant sa main ou un cure-pipe devant le projecteur, Frampton actualise un film possible pour en proposer une définition minimale. « Il semble bien que soit film tout ce qu’on peut mettre dans un projecteur et qui en module le faisceau de lumière » [19]. Le conférencier insiste sur les conditions de l’expérience filmique : la mécanique de précision constituée par le projecteur et la partition du film, à la fois « notation et substance de l’œuvre ». Mais que voit le spectateur ? Au-delà du référent, dit-il, c’est le support du film lui-même, constitué d’unités discrètes, qui est le sujet de tous les films. Le film est le matériau de travail du cinéaste. Grâce à l’usage d’outils mécaniques, l’artiste de cinéma (artist in film) peut se tenir éloigné de toute expression personnelle, « enjeu spécifique à une très brève période de l’histoire, aujourd’hui terminée », en retrouvant « les conditions et les limites fondamentales de son art » [20]. Définition moderniste de l’artiste de cinéma, nuancée par un soupçon d’ironie dû au léger trouble qui s’instaure entre l’artiste de cinéma, l’auteur du texte et le conférencier, en écho au texte de Roland Barthes paru l’année précédente, « La Mort de l’auteur » [21]. Qui parle ? Est-ce l’auteur du texte, présent dans la salle mais dissimulé près du projecteur, cinéaste projectionniste ? La voix préenregistrée par un second cinéaste, alter ego de l’auteur ? Où est le conférencier ? Au-delà de son caractère moderniste et autoréférentiel, la conférence œuvre à une dissociation de ses paramètres — la salle, l’écran, le projecteur, le film, le conférencier, la voix — pour proposer au spectateur une expérience d’analyse filmique, proche en ce sens des travaux du paracinema. Pensons à l’installation d’Anthony McCall, Line Describing a Cone (1973) ou aux Yellow Movies (1973) de Tony Conrad qui visent à produire chez le spectateur une réflexion sur la nature du film.
En février 1964 au Surplus Dance Theater de New York, Robert Morris donne une conférence, intitulée « 21.3 » [22]. Mimant le protocole classique de la conférence (pupitre, carafe et verre d’eau), l’artiste lit l’introduction du texte de Panofksy, Studies in Iconology, (Essais d’iconologie, 1939) mais l’auditeur s’aperçoit rapidement que les mouvements du causeur et la voix diffusée ne coïncident pas. Morris utilise en fait sa propre voix préenregistrée et procède à un play-back en suivant une partition qui codifie également chacun de ses gestes. Réduite à une sorte de simulacre burlesque, l’autorité scientifique est sapée par la chorégraphie de l’artiste. Rappelons que Morris vient d’être nommé au Hunter College au moment de sa conférence, exerçant une ironie sur sa propre situation d’enseignant [23]. Qu’il s’agisse de la discrépance opérée par les lettristes, des contraintes de lecture cagiennes ou des dispositifs techniques d’enregistrement utilisés par Morris ou Frampton, on peut s’interroger sur l’insistance de la disjonction entre le corps et la parole, l’image et le son. Ces stratégies ne sont pas sans rappeler l’art de la ventriloquie qui voit le sujet se dédoubler de manière simultanée en causeur et en écouteur, échapper au synchronisme, manifester des effets d’« inquiétante étrangeté » [24]. Sans doute l’impératif de dissociation vocale est-il la condition de possibilité d’un acte réflexif de la part de l’artiste ou du cinéaste, doubleur dédoublé à la manière d’un ventriloque. Lors de l’inauguration du Pacific Cine Centre de Vancouver en 1986, différents artistes et cinéastes sont invités à venir présenter leur conception de l’avant-garde. Participent à ce colloque Michael Snow, Patricia Gruben, David Rimmer, Joyce Wieland, Ross McLaren et Al Razutis. L’intervention de ce dernier est assez singulière. Une marionnette posée sur ses genoux, il simule une situation de ventriloquie grâce à un enregistrement, procédé technique qui lui permet d’exercer une moquerie caustique sur l’importance de la psychanalyse dans les analyses filmiques. Peu après son intervention, il bombe au bas de l’écran la phrase : «AVANT-GARDE SPITS IN THE FACE OF INSTITUTIONAL ART.» Documenté dans le film On the Autonomy of Art in Bourgeois Society, ou Splice (Doug Chomyn, Scott Haynes et Al Razutis, 1986), l’épisode témoigne d’une scission de la figure de l’artiste (ou du maître) qui lui permet d’œuvrer, par le biais d’un fétiche, à une critique radicale et désabusée de l’avant-garde. C’est en procédant à un effort de dissociation que le cinéaste est en mesure de réfléchir sa propre pratique et de définir sa position.
On remarquera que chacune de ces performances ou stratégies artistiques traduit une situation de crise : clôture de l’avant-garde, relation à l’institution, dédoublement de l’artiste en professeur. Assurément la place prise aujourd’hui par la conférence dans le champ de l’art contemporain, la manière dont le film est parfois performé sous la forme d’un simple énoncé, la dissociation ironique des éléments du discours esthétique, le renversement de la séance, sont les signes d’un âge critique (ou d’un «tournant éducatif») du cinéma contemporain qui nous invitent à considérer la conférence comme un paradigme dans l’histoire (au futur antérieur) du cinéma élargi. Le cinéma est entré dans son âge ventriloque.
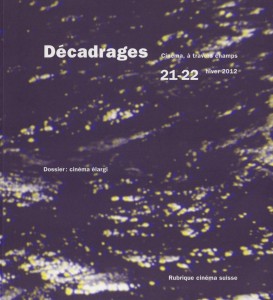 Ce texte a été publié dans la revue Décadrages, n°21-22, « Cinéma élargi », Lausanne, 2012, p. 27-37.
Ce texte a été publié dans la revue Décadrages, n°21-22, « Cinéma élargi », Lausanne, 2012, p. 27-37.
—–
[1] Cf. Jean-Marc Chapoulie, Alchimicinéma, Dijon, Les presses du réel, 2008 ; Jean-Christophe Royoux, « Un remake multipiste », https://www.pointligneplan.com/un-remake-multipiste. [2] Cf. Till Roeskens, « À propos de certains points dans l’espace », Cahiers du post-diplôme, n° 1, Poitiers, École européenne supérieure de l’image, 2011, p. 120-125 ; Marcelline Delbecq, « Des impressions, des ombres », Trafic, n° 72, Paris, P.O.L., Hiver 2009, p. 136-142. ; Louise Hervé et Chloé Maillet, « La performance de Prosper Enfantin », dans Benoît Maire (dir.), Vivre dangereusement… jusqu’au bout, Paris, Palais de Tokyo, Éditions du Cercle d’art, 2011, p. 69-85. [3] Paul O’Neill et Mick Wilson (dir.), Curating and the Educational Turn, Londres, Open Editions / de Appel, 2010. [4] Thomas Clerc, « Le régime didactique de la performance », artpress 2, n° 18, Performances contemporaines 2, 2010, p. 103-112. [5] Lire à ce sujet Jacques Perriault, Mémoires de l’ombre et du son, Paris, Flammarion, 1981 ; Germain Lacasse, Le Bonimenteur de vues animées, Paris/Québec, Méridiens Klincksieck/Nota Bene, 2000 ou, plus récemment, Rick Altman, Silent Film Sounds, New York, Columbia University Press, 2004 ; Giusy Pisano, Valérie Pozner (dir.), Le muet a la parole, Paris, AFRHC, 2005 ; Alain Boillat, Du bonimenteur à la voix-over, Lausanne, Éditions Antipodes, 2007. [6] La première conférence fut donnée par Paul-Émile Victor en 1945 à la salle Pleyel à Paris. Citons parmi quelques-uns des conférenciers : Éric Courtade, Claude Pavart, Yves et Alain Mahuzier, René Vernadet, Gaston Rébuffat, Vitold de Golish, Marcel Isy-Schwart, Louis Panassié. Il serait intéressant d’étudier la relation entre la forme de la conférence géographique illustrée et les dispositifs de parole, parfois en direct, des films de Jean Rouch. [7] Claude Lévi-Strauss, Tristes tropiques, Paris, Plon, 1955, p. 14. [8] Selon le système de classification de Hynek, les rencontres rapprochées désignent l’expérience d’un témoin face à un OVNI. Ces rencontres sont de trois types en fonction de la proximité du contact, de la présence de traces ou d’un éventuel occupant. [9] Volker Pantenburg adresse cette question dans « 1970 and Beyond. Experimental Cinema and Installation Art », in G. Koch, V. Pantenburg, S. Rothöhler (dir.), Screen Dynamics. Mapping the Borders of Cinema, Vienne, Österreichisches Filmmuseum, 2012, p. 78-92. Lire également sous l’angle exclusivement anglo-saxon, Steven Ball, David Curtis, David, A. L. Rees, Duncan White (dir.), Expanded Cinema, Londres, Tate Publishing, 2011. [10] Isidore Isou, « Esthétique du cinéma », ION, n° spécial sur le cinéma, Paris, 1952 [rééd. Jean-Paul Rocher Éditeur, Paris, 1999, p. 152.] [11] Il serait intéressant d’étudier en relation avec la « conférence comme film » le « film comme conférence ». C’est déjà le cas d’Isou avec Traité de bave et d’éternité. Nous pourrions citer par exemple, outre les films situationnistes de Guy Debord, Le Gai Savoir (Godard, 1968), Le Camion (Duras, 1977), Hitler, un film d’Allemagne (Syberberg, 1978) ou Histoire(s) du cinéma (Godard, 1988-98). [12] Maurice Lemaître, Le film est déjà commencé ?, Paris, Éditions André Bonne, 1952, p. 71. [13] Frédérique Devaux, Le Cinéma lettriste, Paris, Paris Expérimental, 1992, p. 190. [14]; John Cage, Silence [1961], trad. Monique Fong, Paris, Denoël, 2004, p. 11. [15] Ibid. [16] Cf. Hollis Frampton, « Une conférence », trad. S. Chauvin, repris dans L’Écliptique du savoir, Paris, Éditions Centre Georges Pompidou, 1999, p. 119-125. [« A Lecture », in Circles of Confusion, Rochester, Visuel Studies Workshop Press, 1985, p. 193-199]. L’enregistrement de la conférence par Michael Snow est disponible sur le double DVD édité par Criterion, A Hollis Frampton Odyssey, 2012,. [17] « Une conférence », op. cit., p. 120. [18] Ibid., p. 120. [19]Ibid., p. 122. [20] Ce rejet de l’expression personnelle n’est pas sans rappeler l’anecdote racontée par Cage. « Une élève de Mies van der Rohe est venue le trouver et lui a dit, “ J’ai du mal à travailler avec vous. Vous ne laissez aucune place à l’expression personnelle. ” Il lui a demandé si elle avait un stylo sur elle. Elle a dit que oui. Il lui a dit “ Écrivez votre nom ”. Elle a écrit son nom. Il lui a dit, “ Voilà ce que j’appelle expression personnelle ”. (Silence, op. cit., p. 158) [21] Le texte de Roland Barthes paraît d’abord en anglais en 1967 dans la revue Aspern 5+6, numéro conçu et édité par Brian O’Doherty sous la forme d’une boîte consacrée au minimalisme. Mentionnons également le texte de la célèbre conférence de Michel Foucault, « Qu’est-ce qu’un auteur ? », publié en 1969, repris dans le volume Dits et écrits I, Paris, Gallimard, 2001, p. 817-849. Foucault donnera en 1979 une version modifiée de cette conférence à l’Université de Buffalo (État de New York) où enseigne Hollis Frampton dans le Département de Media Study. [22] Lire notamment Anaël Lejeune, « 21.3 (ou le discours claudicant) », (Sic), n° 1, octobre 2006, Bruxelles, p. 7-15 ; Paul Bernard, « Morris schizophone, Notes sur 21.3 », Volume 04, 2012, Paris, p. 97-104. À l’instigation de Robert Morris, la performance a été rejouée par Michael Stella, filmée par Babette Mangolte, en 1994. Cette version est désormais diffusée dans les expositions rétrospectives de l’artiste. [23] La conférence de Frampton doit être interprétée comme un commentaire indirect, une reprise, de la performance de Morris. Notons qu’ils sont tous les deux enseignants au Hunter College en 1968. [24] Je me permets de renvoyer à mon texte « Un film en moins », paru en brochure pour l’exposition La Fabrique des films (Maison d’art Bernard Anthonioz, Nogent-sur-Marne, 2012), à l’initiative de pointligneplan, repris dans les Cahiers du post-diplôme, n° 2, Poitiers, École européenne supérieure de l’image, 2012, p. 76-83. Lire également, dans une perspective lacanienne, l’ouvrage récent de Mladen Dolar, Une voix et rien d’autre, trad. Christine Vivier, Caen, Nous, 2012, notamment le chapitre « “Physique” de la voix », p. 75-103.